23 janvier 2024
Qui est ma mère, et qui sont mes frères?
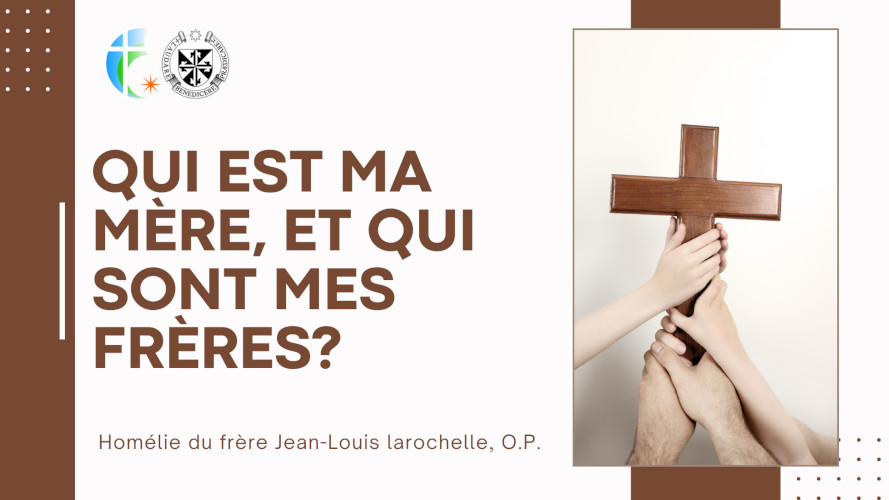
DEUXIÈME LIVRE DE SAMUEL (6, 12b-15.17-19)
En ces jours-là, David fit monter l’arche de Dieu de la maison d’Obed-Édom jusqu’à la Cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l’Arche eurent avancé de six pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d’un pagne de lin, dansait devant le Seigneur, en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d’Israël firent monter l’arche du Seigneur parmi les ovations, au son du cor.
Ils amenèrent donc l’arche du Seigneur et l’installèrent à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix.
Quand David eut achevé d’offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes : pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisins. Ensuite tout le monde s’en retourna chacun chez soi.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (3, 31-35)
En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. »
Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »
Homélie
Le récit évangélique du jour est déroutant pour bien des chrétiens et chrétiennes. En effet, dans un passage qui précède le texte d’aujourd’hui, nous pouvons lire : « Les gens de sa parenté vinrent pour s’emparer de lui (Jésus). Car ils disaient : ‘Il a perdu la tête’ (Mc 3, 21) ». Chose certaine, ses proches étaient suffisamment convaincus du dérangement psychologique de Jésus pour les amener à entreprendre un voyage, à pied, d’environ 60 kilomètres pour se rendre à Capharnaüm, localité où Jésus avait établi sa base. Ce qui surprend particulièrement, c’est que Marie, la mère de Jésus, avait fait, elle aussi, ce voyage avec les autres membres de la famille. C’est dire à quel point Jésus inquiétait les siens. Personne, parmi ses proches, n’avait prévu le coup. L’écart entre ce qu’ils avaient vu, pendant des années, alors qu’il exerçait son métier d’artisan à Nazareth et ce qu’ils observaient maintenant était exorbitant, incompréhensible. Jamais, à leur connaissance, Jésus n’avait manifesté un quelconque pouvoir de guérisseur et pas davantage des capacités d’enseigner et d’entraîner des foules par la puissance et l’originalité de sa parole. D’un homme à la vie discrète, cachée, il était devenu, en très peu de temps, un personnage public qui suscitait la curiosité autant que l’admiration. Comment alors ne pas être perturbé en présence d’une telle transformation? d’un tel mystère?
Or, face au projet de ses proches de l’arrêter et de le ramener à Nazareth, Jésus s’est permis de mettre en question une règle fondamentale de toute vie familiale à l’époque. Avec sa question : « Qui est ma mère, et qui sont mes frères? », Jésus s’est fait contestateur. Il a laissé entendre que l’appartenance familiale pouvait constituer un véritable frein dans le désir de faire la volonté de Dieu. N’a-t-il pas dit : « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère »?
Pour saisir la portée de la parole de Jésus, nous devons nous rappeler qu’en son temps, dans le Proche Orient ancien, la solidarité première était celle liée à la famille (immédiate et élargie). C’est elle qui assurait la sécurité matérielle de ses membres et leur identité sociale. Prendre ses distances par rapport à sa famille, c’était une option quasi impensable. Si quelqu’un tentait de le faire, ses proches exerçaient alors sur lui des pressions pour qu’il se conforme à la règle de la solidarité. S’il n’obéissait pas, il pouvait se faire marginaliser et même être renié. Or, Jésus, en affirmant que ses véritables mère et frères étaient ceux qui faisaient la volonté de son Père, indiquait clairement que le critère premier des solidarités à entretenir ne relevait pas des liens du sang, mais de l’engagement à collaborer à la venue du Règne de Dieu. En d’autres mots, si les intérêts de la famille naturelle venaient s’opposer à ceux de la nouvelle famille spirituelle proposée par Jésus, c’étaient les intérêts de cette dernière qu’il fallait privilégier. Façon de dire que le choix de vivre l’Évangile entraîne nécessairement l’acceptation de rompre certaines appartenances familiales, sociales ou professionnelles. C’est ce que les disciples de Jésus ont pris le risque de faire.
Encore aujourd’hui, que de chrétiens et chrétiennes font des choix qui paraissent excessifs aux yeux de leur entourage. Ainsi voit-on des couples chrétiens s’investir, en temps et en argent, pour soutenir des familles de réfugiés et de migrants. Ce ne sont pas leurs intérêts personnels ou familiaux qu’ils défendent alors, mais plutôt ceux de personnes dans le besoin. Dans ce but, ils s’oublient, ils se laissent habiter par la parole de Jésus : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Puisse l’Esprit du Christ nous rendre capables de cultiver les appartenances qui sont sources de fécondité évangélique!
Fr. Jean-Louis Larochelle, O.P.
PRIÈRE
Dieu éternel et tout-puissant,
augmente en nous la foi, l’espérance et la charité;
et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets,
fais-nous aimer ce que tu commandes.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
lui qui vit et règne avec toi
dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles.
∞ Amen.
